Le prix Nobel de physique 2023 a été attribué à trois scientifiques pour leurs travaux sur les attosecondes, qui pourraient conduire à des percées en électronique et en chimie.

Trois scientifiques Pierre Agostini, Ferenc Krausz et Anne L'Huillier ont reçu le prix Nobel de physique 2023. Photo : CNN
L'Académie royale des sciences de Suède a annoncé que les scientifiques Pierre Agostini (55 ans), Ferenc Krausz (61 ans) et Anne L'Huillier (65 ans) sont les lauréats du prix Nobel de physique 2023, pour leurs méthodes expérimentales de création d'impulsions lumineuses attosecondes pour étudier la dynamique des électrons dans la matière, à 16h45 le 3 octobre (heure de Hanoï).
Leurs travaux avec les lasers ont donné aux scientifiques les outils pour observer et même contrôler les électrons. Cela pourrait favoriser des avancées dans des domaines aussi divers que l’électronique et la chimie.
Une attoseconde est un milliardième de milliardième de seconde. Pour mettre cela en perspective, le nombre d’attosecondes dans une seconde équivaut au nombre de secondes dans toute l’histoire de l’univers, longue de 13,8 milliards d’années. Selon Hans Jakob Woerner, chercheur à l'École polytechnique fédérale de Zurich (ETH Zurich), l'attoseconde est la période de temps la plus courte que l'homme puisse mesurer directement.
La capacité à fonctionner dans ce laps de temps est importante car c'est à cette vitesse que fonctionnent les électrons, les composants essentiels des atomes. Par exemple, il faut 150 attosecondes à un électron pour se déplacer autour du noyau d’un atome d’hydrogène.
Cela signifie que l’étude des attosecondes donne aux scientifiques accès à un processus fondamental qui était auparavant hors de portée. Chaque appareil électronique est affecté par le mouvement des électrons, et la limite de vitesse actuelle est de quelques nanosecondes, selon Woerner. Si les microprocesseurs étaient convertis en attosecondes, il serait possible de traiter l’information un milliard de fois plus vite.
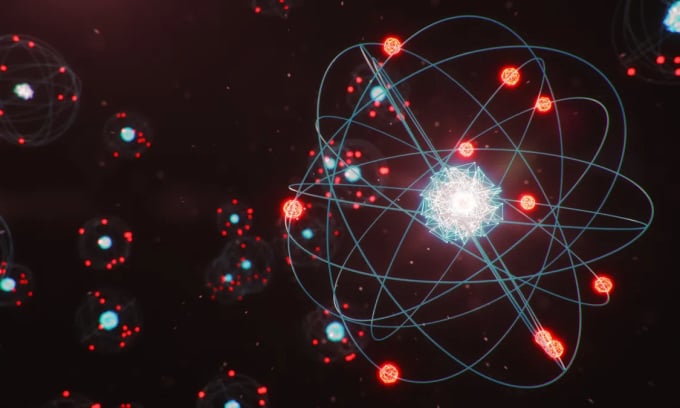
Un atome est constitué d'un noyau constitué de protons et de neutrons, entouré d'électrons. Photo : Rost-9D/Getty
La physicienne suédoise d'origine française Anne L'Huillier a été la première à découvrir un outil permettant d'ouvrir le monde de l'attoseconde. Cet outil utilise un laser haute puissance pour produire des impulsions lumineuses à des intervalles extrêmement courts.
Franck Lépine, chercheur à l'Institut français de la lumière et de la matière qui a travaillé avec L'Huillier, décrit le dispositif comme un film fait pour les électrons. Il le compare au travail de deux pionniers du cinéma français – les frères Auguste et Louis Lumière – qui construisaient des scènes en prenant des photographies successives. « C'est comme un appareil avec des impulsions lumineuses extrêmement rapides qui peuvent être dirigées vers des matériaux pour obtenir des informations sur leur réponse au cours de cette période », explique John Tisch, professeur de physique laser à l'Imperial College de Londres.
Les trois vainqueurs d'hier détenaient auparavant le record du monde de l'impulsion lumineuse la plus courte. En 2001, l'équipe du scientifique français Pierre Agostini a créé une impulsion lumineuse d'une durée de seulement 250 attosecondes. Le groupe de L'Huillier a dépassé ce record avec 170 attosecondes en 2003. En 2008, le physicien hongro-autrichien Ferenc Krausz a réduit ce nombre de plus de moitié avec une impulsion de 80 attosecondes.
Le détenteur du record du monde Guinness de l'impulsion lumineuse la plus courte est l'équipe de Woerner, avec une durée de 43 attosecondes. Le temps pourrait être encore réduit à quelques attosecondes seulement avec la technologie actuelle, estime Woerner.
La technologie attoseconde n’est pas encore devenue courante, mais l’avenir semble prometteur, selon les experts. Jusqu’à présent, les scientifiques ont pu utiliser les attosecondes presque exclusivement pour observer les électrons. Selon Woerner, contrôler les électrons et manipuler leurs mouvements n’est pas encore fondamentalement possible, ou commence seulement à le devenir. Cela pourrait rendre l’électronique beaucoup plus rapide et déclencher une révolution dans la chimie.
« Nous ne serons pas limités à ce que les molécules font naturellement, mais nous pourrons les adapter à nos besoins », explique Woerner. L'atomochimie pourrait conduire à des cellules solaires plus efficaces, a-t-il ajouté, ou même utiliser l'énergie lumineuse pour produire des carburants propres.
Thu Thao (Selon AFP )
Lien source


![[Photo] Le Premier ministre Pham Minh Chinh préside la réunion ordinaire du gouvernement en mars](https://vstatic.vietnam.vn/vietnam/resource/IMAGE/2025/4/6/8393ea0517b54f6791237802fe46343b)
![[Photo] Médecins militaires dans l'épicentre du Myanmar](https://vstatic.vietnam.vn/vietnam/resource/IMAGE/2025/4/6/fccc76d89b12455c86e813ae7564a0af)

















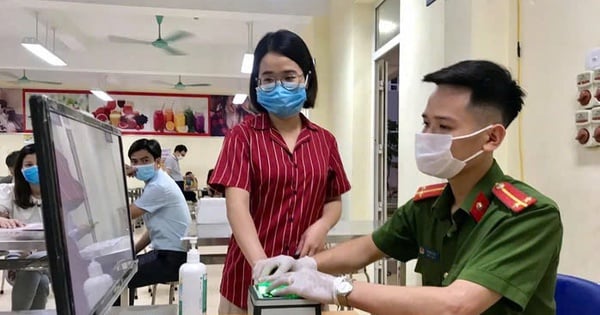



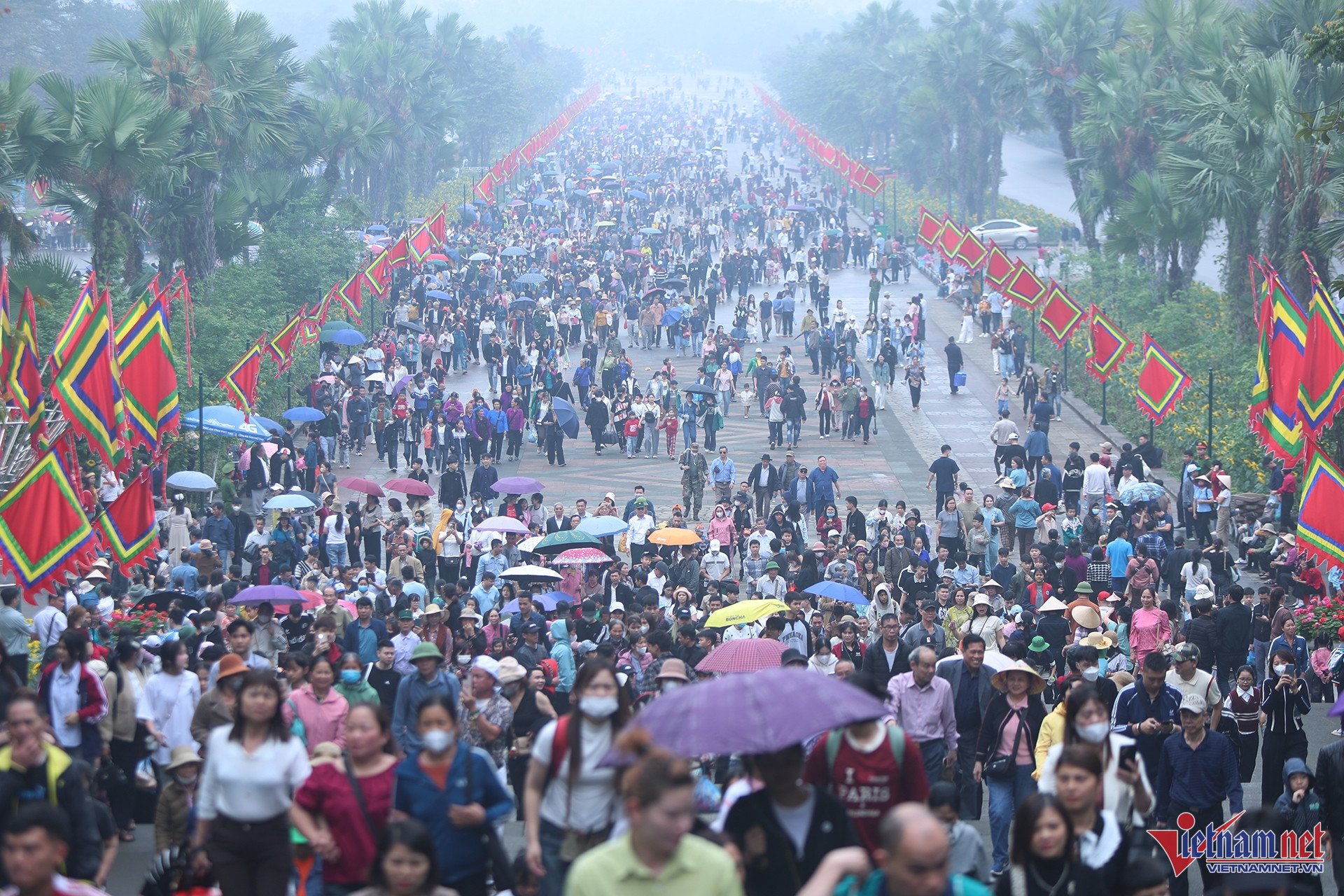






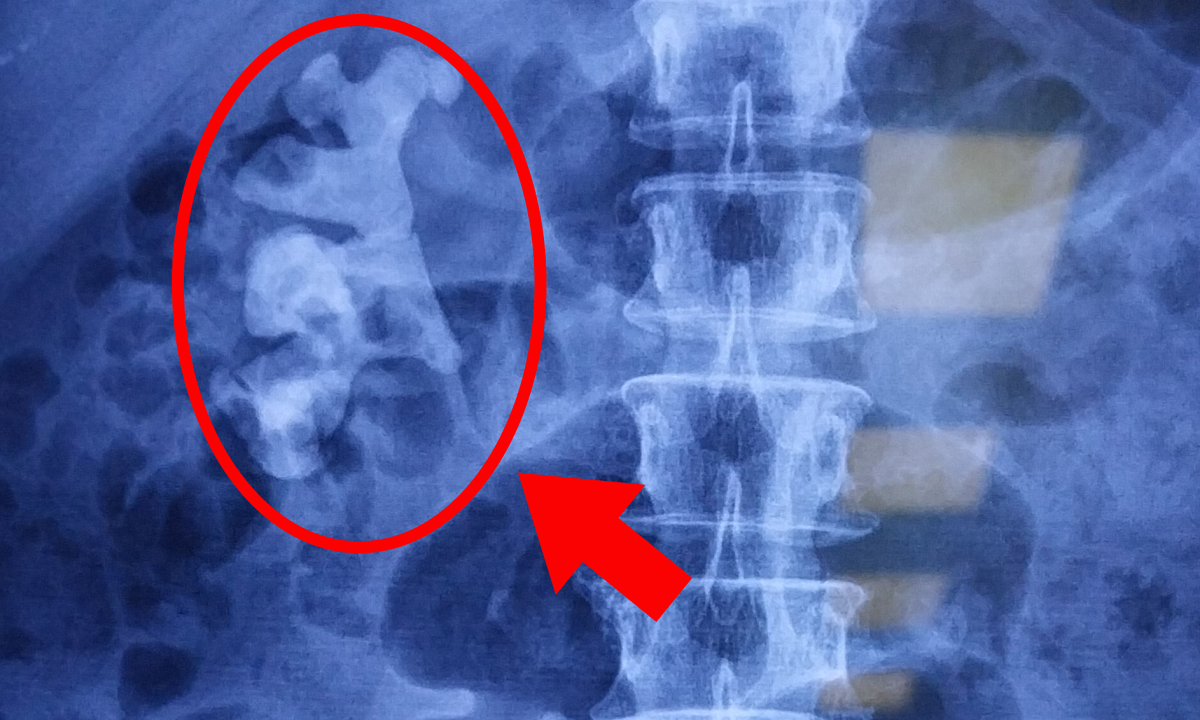



















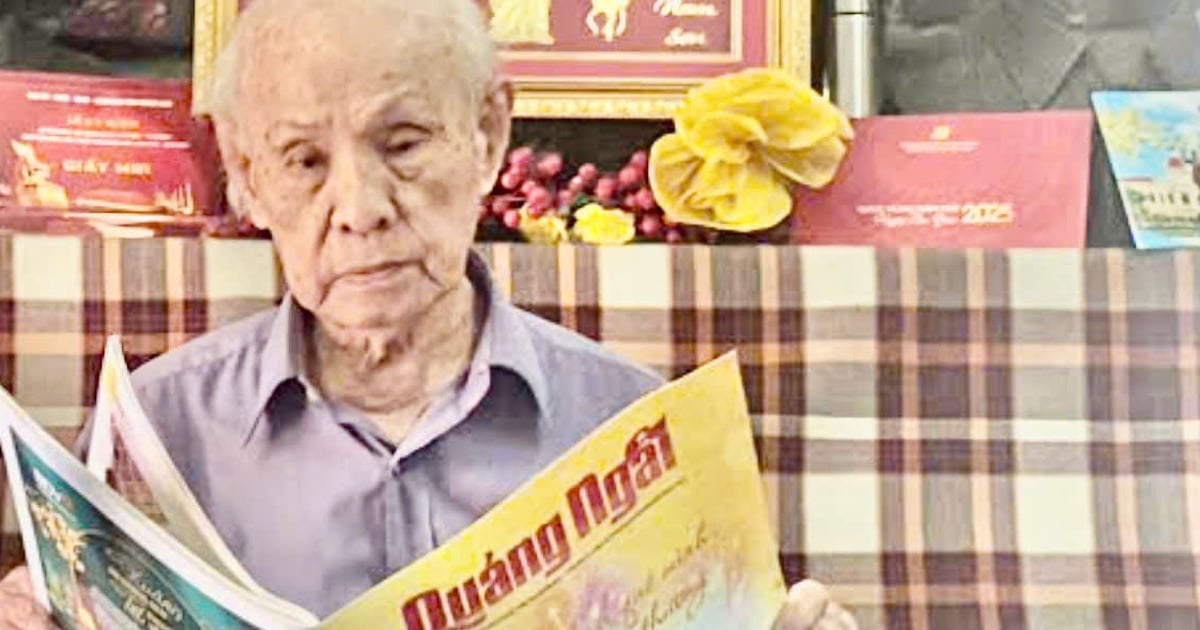








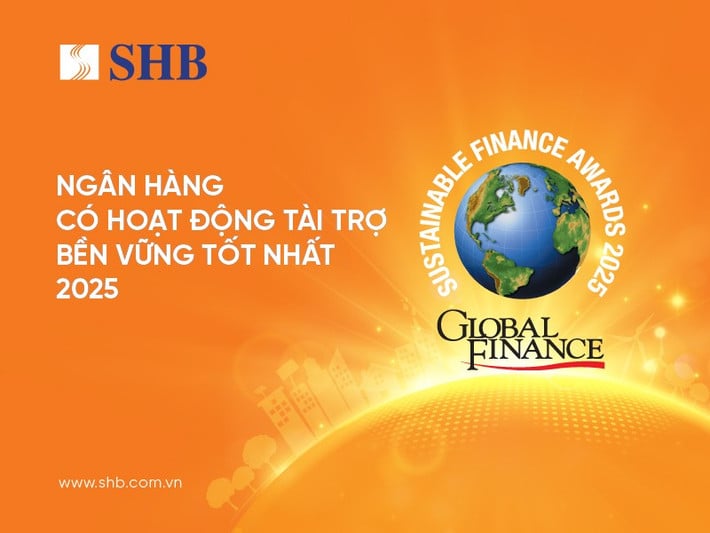






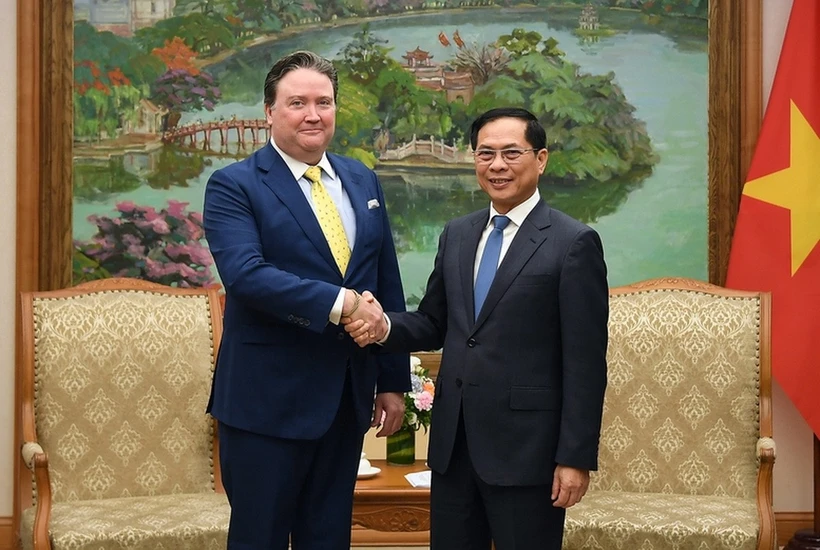







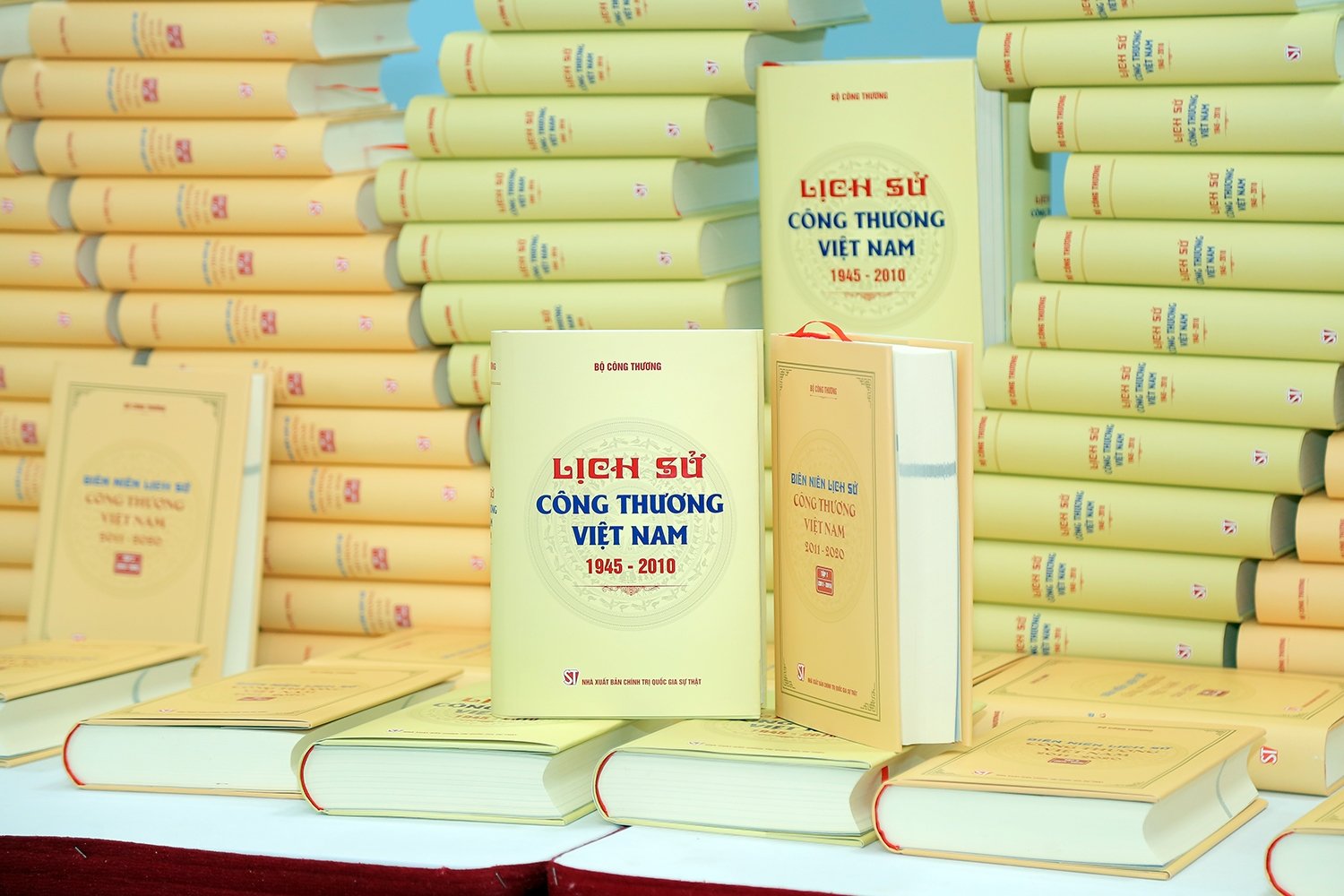
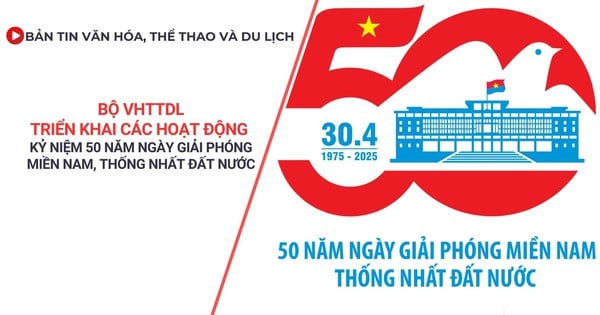



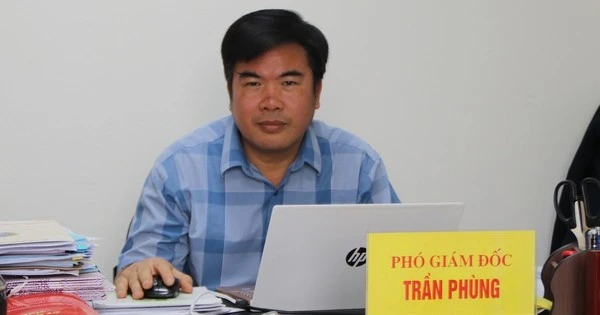












Comment (0)