L’aide médicale se situe à l’intersection de la diplomatie, de l’humanitaire et de l’élaboration de politiques stratégiques.
C’est l’opinion de M. Darryl Scarborough (*) dans l’article Health Aid and Global Influence: Balancing Diplomacy, Development, and Equity publié sur Modern Diplomacy le 6 février.
Selon M. Scarborough, l’aide à la santé ne vise pas seulement à répondre aux problèmes urgents de santé publique, mais constitue également un outil permettant aux pays donateurs d’étendre leur influence géopolitique. Dans le contexte d’une pandémie marquée par de nombreuses inégalités et une fragilité des infrastructures sanitaires, le besoin d’un mécanisme d’aide sanitaire efficace et équitable est plus urgent que jamais. On peut dire que l’aide médicale est à la fois un besoin humanitaire et un outil politique, nécessitant une analyse approfondie de ses motivations, de ses impacts et de ses conséquences à long terme.
L’article de Darryl Scarborough dans Modern Diplomacy examine les approches régionales de l’aide à la santé, l’implication des acteurs étatiques et non étatiques et le rôle des cadres durables qui privilégient l’équité en santé par rapport à la concurrence entre les donateurs.
Comprendre l’interaction complexe entre le pouvoir et la politique dans l’aide à la santé mondiale aidera les localités à mettre en place des initiatives de santé plus efficaces, à autonomiser les communautés et à renforcer les systèmes de santé dans le monde entier.
Washington et le programme au Kenya
En 2003, le président américain de l’époque, George W. Bush, a lancé le Plan mondial d’urgence de lutte contre le sida (PEPFAR) pour répondre à la crise mondiale du VIH/sida. Il s’agit là également d’un exemple typique du caractère stratégique de l’aide médicale.
Selon M. Scarborough, ce programme a fourni des traitements contre le VIH/SIDA qui ont sauvé des millions de vies, renforcé l’infrastructure médicale et renforcé les relations diplomatiques entre les États-Unis et le Kenya.
Les critiques soutiennent cependant que l’approche verticale du PEPFAR privilégie l’imagerie et les résultats mesurables plutôt que l’intégration dans le système de santé global, laissant de nombreux autres besoins de santé importants sous-financés.
 |
| Les filles à St. John à Nairobi, au Kenya, assiste à un événement soutenu par le PEPFAR. (Source : PEPFAR) |
En outre, a commenté M. Scarborough, le PEPFAR se concentre sur les interventions d’urgence contre le VIH/SIDA, mais cela pose également un problème plus important : comment équilibrer les programmes de traitement spécifiques à une maladie avec la construction d’un système de santé durable ?
La dépendance au financement étranger soulève également des inquiétudes quant à la durabilité du programme, car si les donateurs changent de priorités, les résultats pourraient être menacés.
Sans une intégration plus étroite dans les systèmes de santé locaux, les progrès dans le traitement du VIH/SIDA pourraient être vulnérables aux fluctuations du financement et aux ajustements de la stratégie géopolitique.
L'empreinte de Pékin en Éthiopie
Contrairement à l’approche américaine, la Chine a mis en œuvre des projets de santé en Éthiopie dans le cadre de l’Initiative Ceinture et Route (BRI) en construisant des hôpitaux et en formant du personnel médical.
M. Scarborough a déclaré que ces investissements dans les infrastructures non seulement améliorent l’image de Pékin et ses relations diplomatiques, mais contribuent également à résoudre de nombreux problèmes importants en matière d’accès aux services de santé. Cependant, ces projets manquent souvent du système de soutien nécessaire pour assurer leur durabilité à long terme.
Les différences entre le PEPFAR et le modèle chinois reflètent également les différentes priorités des donateurs. Alors que Washington se concentre sur des interventions sanitaires urgentes et ciblées, Pékin investit dans le développement d’infrastructures de santé à long terme.
En outre, le succès des hôpitaux construits en Chine ne dépend pas seulement des infrastructures, mais aussi d’investissements synchronisés dans la formation des ressources humaines et de la garantie de ressources financières pour leur fonctionnement. Sans ces éléments, les projets risquent de devenir des symboles d’investissement étranger plutôt que des solutions de santé durables.
 |
| La Chine a mis en œuvre des projets de santé en Éthiopie dans le cadre de l’Initiative Ceinture et Route (BRI) en construisant des hôpitaux et en formant du personnel médical. (Source : Xinhua) |
Impact régional
La répartition de l’aide sanitaire montre également de nettes disparités régionales, a souligné M. Scarborough.
En Afrique subsaharienne, et notamment en Afrique de l’Est, où vivent environ 64 % des personnes infectées par le VIH dans le monde, les nouvelles infections ont considérablement diminué au cours des 30 dernières années. Cependant, malgré de nombreux progrès dans la lutte contre la maladie du siècle, cet endroit est toujours confronté à un sérieux défi : un taux élevé de mortalité maternelle.
En 2020, cette sous-région représentait 69 % de tous les décès maternels dans le monde, ce qui indique que de nombreux autres problèmes de santé restent sans réponse.
Pendant ce temps, dans les Balkans, de nombreux programmes de l’Union européenne continuent de soutenir l’amélioration des systèmes de santé, mais l’instabilité économique et politique persistante entrave toujours les réformes globales de la gouvernance de la santé.
L’efficacité de l’aide sanitaire est liée aux structures de gouvernance et à la stabilité politique, a souligné M. Scarborough.
En Afrique de l’Est, outre les programmes de contrôle des maladies infectieuses, la priorité doit être donnée à l’investissement dans la santé maternelle et infantile. De même, les modèles d’aide sanitaire durables dans les zones politiquement instables doivent être alignés sur les priorités locales et se concentrer sur le renforcement des capacités à long terme.
Concurrence entre sponsors
Selon l’expert, les pays bénéficiaires de l’aide doivent faire preuve de plus en plus de flexibilité face aux différentes priorités afin de maximiser les bénéfices des donateurs.
 |
| L’aide sanitaire ne vise pas seulement à répondre aux défis urgents en matière de santé publique, mais constitue également un outil permettant aux pays donateurs d’étendre leur influence géopolitique. (Source : Stanford Medicines) |
Par exemple, l’Ouganda a des partenariats stratégiques avec les États-Unis et la Chine, exploitant les ressources de Washington pour le traitement du VIH/SIDA et celles de Pékin pour le développement des infrastructures.
Cet équilibre démontre le rôle de plus en plus actif des pays bénéficiaires dans la définition de la manière dont l’aide est allouée.
En outre, pour gérer efficacement divers programmes d’aide, les pays ont besoin d’institutions nationales fortes, capables de coordonner les flux d’aide et de garantir leur alignement sur les priorités nationales.
Mais cette démarche comporte également des risques : la concurrence entre les donateurs pourrait conduire à une dépendance politique et à des stratégies de santé fragmentées.
Les pays bénéficiaires doivent donc mettre en place des institutions solides pour réduire leur dépendance au financement extérieur et négocier l’aide de manière stratégique.
Motif politique
L’aide médicale reflète souvent des stratégies géopolitiques plus larges, a affirmé M. Scarborough.
Pendant la guerre froide, l’aide médicale américaine a servi d’outil pour contrer l’influence soviétique par le biais de la diplomatie du soft power.
Aujourd’hui, les investissements de la Chine dans la santé mondiale s’inscrivent dans son objectif d’étendre son influence dans les pays du Sud.
Ces motifs montrent ainsi que l’aide médicale est rarement une activité neutre.
Alors que les pays donateurs utilisent l’aide sanitaire pour renforcer leur position géopolitique, les pays bénéficiaires doivent équilibrer les influences extérieures tout en donnant la priorité aux besoins de santé nationaux.
Le principal défi consiste désormais à garantir que l’aide à la santé favorise un développement local durable plutôt que de devenir un instrument de contrôle externe.
 |
| Cuba déploie des équipes médicales en Amérique latine, non seulement pour fournir des services médicaux essentiels, mais aussi pour étendre l’influence idéologique de son pays. (Source : Peoples Dispatch) |
Par ailleurs, l’aide médicale est également liée aux objectifs politiques des pays. En Asie du Sud-Est, la diplomatie sanitaire japonaise se concentre généralement sur la préparation aux catastrophes, en réponse à la fréquence des catastrophes naturelles dans la région. Pendant ce temps, Cuba a déployé des équipes médicales en Amérique latine, non seulement pour fournir des services médicaux essentiels, mais aussi pour étendre l’influence idéologique de son pays.
On peut dire que ces deux modèles d’aide distincts reflètent la manière dont les stratégies de santé démontrent à la fois l’engagement humanitaire et servent les objectifs diplomatiques nationaux.
L’accent mis par le Japon sur le renforcement de la résilience souligne l’importance des mesures de santé préventives, tandis que l’exportation de professionnels de la santé par Cuba souligne le rôle des ressources humaines dans la diplomatie de la santé.
Ces deux approches démontrent l’intersection entre les priorités de santé mondiale et les stratégies politiques, affirmant le potentiel de l’aide sanitaire comme pont humanitaire et diplomatique.
Entité non étatique
Les acteurs non étatiques, notamment les organisations non gouvernementales (ONG), les fondations philanthropiques et les sociétés multinationales, jouent un rôle de plus en plus essentiel dans l’élaboration de l’aide à la santé mondiale.
Par exemple, la Fondation Gates (une organisation caritative privée fondée en 2000 par le cofondateur de Microsoft Bill Gates et son épouse, la femme d’affaires Melinda Gates) a apporté des contributions significatives aux efforts mondiaux d’éradication du paludisme, complétant de nombreuses initiatives menées par les gouvernements.
Toutefois, le recours aux acteurs non étatiques pose également des problèmes, en particulier lorsque leurs programmes ne sont pas efficacement intégrés aux stratégies nationales de santé.
En outre, l’influence croissante des organisations privées nécessite une coordination plus étroite avec les initiatives de santé menées par le gouvernement. Lorsque les acteurs non étatiques agissent conformément aux priorités nationales, les interventions en matière de santé seront non seulement efficaces, mais contribueront également à renforcer, plutôt qu’à fragmenter, les systèmes de santé existants.
Par-dessus tout, les modèles d’aide sanitaire durables doivent également combiner les efforts des acteurs étatiques et non étatiques pour promouvoir la résilience et créer un impact à long terme.
 |
| La Fondation Gates a apporté des contributions significatives aux efforts mondiaux d’éradication du paludisme, complétant de nombreuses initiatives menées par les gouvernements. (Source : The Independent) |
Vers une aide sanitaire durable
Pour que l’aide à la santé soit efficace et durable, les donateurs doivent élaborer des stratégies adaptées aux structures de gouvernance locales et donner la priorité au renforcement des capacités à long terme.
Le renforcement du système de santé primaire et la promotion de partenariats globaux entre les acteurs étatiques et non étatiques peuvent améliorer la résilience du système de santé tout en réduisant la dépendance à l’aide étrangère.
Selon Scarborough, une aide sanitaire durable nécessite un équilibre entre les solutions d’urgence à court terme et les investissements à long terme dans les capacités sanitaires locales.
Des modèles innovants, tels que les partenariats public-privé ou les initiatives communautaires, ouvrent des voies prometteuses pour atteindre cet objectif.
Cette approche permet non seulement d’utiliser efficacement les ressources et l’expertise nationales, mais elle permet également d’aligner étroitement l’aide internationale sur la stratégie de développement de chaque pays.
---
En bref, l’aide médicale a toujours été un outil important de la diplomatie mondiale, à la fois pour fournir des solutions humanitaires et pour servir les intérêts stratégiques de chaque pays donateur. Toutefois, les résultats inégaux des programmes d’aide dans différentes régions telles que l’Afrique de l’Est, les Balkans, l’Asie du Sud-Est et l’Amérique latine soulignent encore davantage la nécessité d’une stratégie qui équilibre efficacité et équité.
Surtout, à l’avenir, l’aide à la santé devra dépasser les ambitions géopolitiques pour donner la priorité à la transparence, à la coopération et à l’autonomie des pays bénéficiaires. Lorsque les parties prenantes travaillent ensemble pour construire des partenariats solides et donner plus de pouvoir aux acteurs locaux, l’aide à la santé peut devenir un outil de développement durable plutôt qu’un simple reflet d’intérêts politiques concurrents.
(*) M. Darryl Scarborough est un vétéran chevronné et un professionnel du développement international, possédant une vaste expérience de l’aide humanitaire et du maintien de la paix, travaillant à la fois dans les secteurs privé et de la défense.
Source




































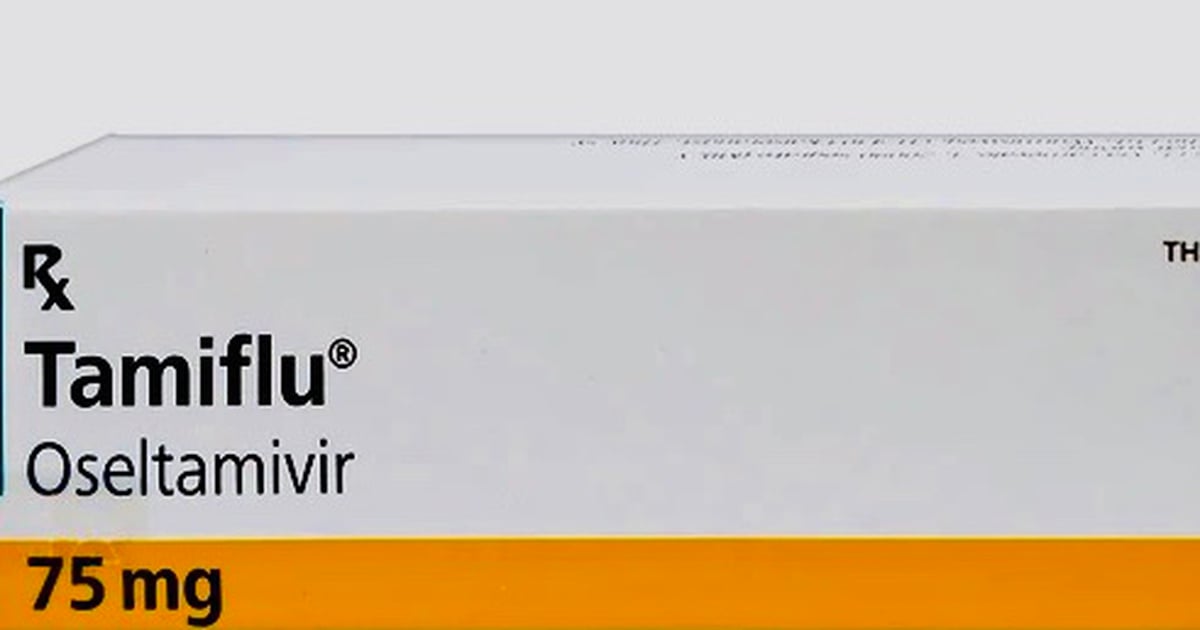






















Comment (0)