Janvier est le mois de la fête…
En 1886, Camille Paris, le découvreur du sanctuaire de My Son, est venu à Van Hoi (ville de Dieu Tri, district de Tuy Phuoc, province de Binh Dinh) les jours précédant le Têt. Dans son ouvrage Voyage d'exploration de Hué en Cochinchine par la Route mandarine , il raconte qu'à cette occasion, « les gens blanchirent leurs maisons, repeignirent leurs autels ancestraux et remplacèrent tous les charmes, amulettes, phrases parallèles et allégories en papier doré qui avaient été accrochés ou collés dans leurs maisons et sur leurs portes depuis le Têt de l'année précédente. » Le docteur Baurac, célébrant le Têt à Saïgon en 1894, disait dans son ouvrage La Cochinchine et ses habitants Provinces de l'Ouest : « pendant le Nouvel An (Têt), on nettoie les tombes, on y brûle des pétards et des amulettes en papier. »

Un érudit vendant des phrases parallèles du Têt, vers 1920-1929
Photo : Musée du Quai Branly
Selon le livre « Tour d'Asie : Cochinchine - Annam - Tonkin » du voyageur Marcel Monnier, le Têt est aussi l'occasion de visiter les boutiques de Cho Lon (Nam Ky), un quartier encore préservé de l'Occident, où « on trouve des restaurants en plein air les uns à côté des autres, des étals de soie et de coton colorés, d'innombrables lanternes colorées, des phrases parallèles d'un mètre de long sur fond rouge avec des caractères dorés signifiant Bonheur et Longévité. Et des villages, les gens affluent pour faire leurs courses. Il y a des charrettes à bœufs, des charrettes à bras, des gens marchant le dos courbé sous de lourds paniers, des malabars [charrettes en verre] à quatre places pour toute la famille, tirés par un cheval maigre. Après avoir fait leurs achats, les gens se dispersent sur toutes les routes, les sentiers étroits entre les rizières, chantant sans cesse tout l'après-midi ».
Selon Camille Paris, pendant la fête du Têt, les restaurants sont très animés : on boit du thé, on boit du vin, on mange des haricots, du riz, des grains de riz blanc comme neige agrémentés de morceaux de porc braisé ou de sauce de poisson. C'était amusant et intéressant. Les enfants étaient bien habillés et portaient des chapeaux à larges bords pour se protéger du soleil. Des plus petits aux plus grands, chacun était habillé différemment. Un touriste français du nom de Pierre Barrelon, venu à Saïgon au début des années 1890, a déclaré : « Les vêtements pour enfants font l'objet d'une attention particulière, car ils sont toujours parmi les plus abondants. Chaque enfant est habillé et soigné de la manière la plus originale possible. »
Monnier écrit que « les maisons étaient décorées ; hommes et femmes changeaient leurs vêtements sombres pour des vêtements clairs, des ceintures couleur cerise ou des foulards verts », « du coucher du soleil à l'aube, feux d'artifice et pétards commémoraient les morts et saluaient l'arrivée de la nouvelle année ».
Lors de la célébration du Têt à Hué en 1886, le Dr Hocquard écrivait dans Une campagne au Tonkin : « Il n'y a pas de commerce, pas de travaux agricoles, pas de travail forcé ; adultes et enfants porteront de beaux vêtements » et « les bureaux du palais royal sont fermés ; à partir du vingt-cinq décembre, la cour cesse de fonctionner, aucun document n'est signé et tamponné jusqu'au onze janvier de l'année suivante ».
Selon Michel Duc Chaigneau, dans son ouvrage Souvenirs de Hué publié à Paris en 1867, la fête du Nouvel An à Hué dure environ 10 jours, tous les travaux sont suspendus 6 à 8 jours avant la fin de l'année lunaire pour que les gens puissent se reposer et s'amuser, les cérémonies de lever et d'abaissement du drapeau et d'ouverture des sceaux sont des activités périodiques indispensables.
Pierre Barrelon a eu l'occasion d'observer les premiers jours du Nouvel An des indigènes et, selon lui, pendant les trois jours de fête, « les indigènes participent aux fêtes et festins les plus fous. Les activités commerciales stagnent, il est impossible de gagner un tube de riz ».
Le docteur Baurac a déclaré que pendant les trois jours du Têt, « tout travail et toute activité commerciale sont suspendus ; les marchés sont fermés. À Saïgon comme dans les gares de l'intérieur, les Européens doivent faire des provisions et s'approvisionner avant le Têt, car pendant ces trois jours de fête, tout est fermé. »
Gagnez de l'argent pour le Têt
Selon Camille Paris, les jours précédant le Têt étaient très animés : « Les gens travaillaient jour et nuit, faute de temps. Des pauvres qui voulaient changer de meubles, aux marchands qui bradaient leurs marchandises, en passant par les vendeurs de pétards, d'encens, de statues de Bouddha, d'effigies en bambou enveloppées dans du papier coloré… Quoi d'autre ? On abattait des cochons, on accumulait des noix d'arec, les riches achetaient du tissu pour faire des écharpes et des chapeaux. Ils avaient besoin d'argent et de nouveauté, sinon ils devaient vendre tous leurs vieux objets. »

Fleurs de pêcher dans la rue pendant le Têt, Hanoï, le 2 février 1929
Photo : Musée du Quai Branly
Selon les observations de Monnier, les besoins en achats des Vietnamiens à Saigon sont les suivants : « Le Têt doit être célébré solennellement, les gens nettoient leurs maisons, décorent l'autel ancestral avec des fleurs et du papier coloré, achètent beaucoup de feux d'artifice et de pétards. Et toutes les économies de la famille y sont investies. » Le Dr Hocquard a écrit que « les misérables vendront leurs biens et emprunteront de l'argent pour avoir assez d'argent pour célébrer le Têt ».
Pierre Barrelon écrit : « Chacun cherche à gagner beaucoup d'argent en vendant ou en mettant en gage tout ce qui est encombrant, car il faut à tout prix avoir de l'argent pour profiter de ces jours de fête. » La touriste britannique Gabrielle M. Vassal, dans son ouvrage Mes trois ans d'Annam (Trois ans en Annam) publié en 1912, partage son expérience du Têt à Nha Trang : « Certains allaient recouvrer des dettes, d'autres cherchaient quelque chose à vendre pour de l'argent. »
réveillon du Nouvel An
Selon les notes du Dr Baurac, au début de l'année, si la troupe de théâtre n'était pas invitée à se produire quelque part, elle devait quand même jouer une pièce pour ouvrir la nouvelle année. À cette époque, « les gens demandaient aux dieux de choisir une pièce qui leur convenait. Ils procédaient ainsi : un enfant incapable de jugement tirait au sort une pièce parmi celles de la troupe ; ils demandaient ensuite leur avis en lançant deux pièces en l'air (xin keo – NV ). Si l'une tombait sur face et l'autre sur pile, le résultat était favorable. Si les deux pièces tombaient sur pile ou face après avoir été lancées, on recommençait. C'était ce qu'on appelait la divination de début d'année : découvrir par la divination quelle pièce ouvrirait la nouvelle année. »
Selon l'érudit Truong Vinh Ky, chaque année après le Têt à Saigon, le général Le Van Duyet organisait un défilé militaire - qui avait une signification politique et religieuse plutôt qu'une superstition. Cette cérémonie a pour but de montrer sa puissance contre toutes les rébellions et de détruire tout mal. La cérémonie d'envoi des troupes se déroulait ainsi : « Juste avant le 16 janvier, après le jeûne, le gouverneur général revêtait sa tenue de cérémonie et se rendait au temple ancestral pour faire son rapport. Après trois coups de canon, il montait sur un palanquin, suivi de soldats. Le gouverneur général était escorté hors de la citadelle par les portes de Gia Dinh Mon ou de Phan Yen Mon, en direction de Cho Vai, puis remontait la rue Mac-Mahon [aujourd'hui Nam Ky Khoi Nghia] jusqu'à l'emplacement des canons. Là, on tirait au canon, on faisait des exercices aux soldats et on testait les éléphants. Le gouverneur général contournait la citadelle par l'arrière, se rendait au chantier naval, participait à un exercice naval, puis revenait à la citadelle. Pendant le défilé, on allumait des canons pour chasser les mauvais esprits qui résidaient dans les maisons. »
JOUER POUR LA CHANCE
L’une des coutumes auxquelles les étrangers accordent une attention particulière est le jeu pendant le Têt. Le jeu est une activité populaire parmi les Vietnamiens, non seulement pour se divertir, mais aussi pour prier pour avoir de la chance pour la nouvelle année. Le Dr Baurac a écrit que les Vietnamiens « grands et petits, jeunes et vieux, riches et pauvres, participent principalement aux jeux ce dernier jour [le 3] ».
Michel Duc Chaigneau a commenté : « Les habitants de Dang Trong aiment jouer pour de l'argent, ils sont passionnés par le jeu entre eux pendant les vacances ». Dans son récit de voyage, Monnier observe qu'« ils [les Vietnamiens] aiment jouer ; mais ce n'est qu'occasionnellement, lors d'occasions spéciales – le Nouvel An, par exemple – qu'ils misent librement leur fortune au jeu des trois quan [c'est-à-dire le jeu de dés ou de boule d'ouverture]. S'ils n'ont pas de chance, ils repartent soulagés ».
Les casinos surgissaient partout, les gens se rassemblaient par groupes de trois ou sept « à l'intérieur de la maison, à l'extérieur de la ruelle, même sur le bord de la route... » pour jouer les uns avec les autres, ce qui pouvait durer toute la nuit. Celui qui avait la malchance de perdre tout son argent courait partout et empruntait de l'argent pour continuer à prier pour avoir de la chance, selon Michel Duc Chaigneau.
Mme Vassal a également raconté le jeu de hasard populaire à Nha Trang à cette époque auquel tout le monde aimait jouer, à savoir le « poker à trois cartes ». « Les gens vendent même des vêtements neufs pour continuer à jouer », « ainsi les pauvres artisans habiles et intelligents restent pauvres ».
Monnier écrivait avec assurance que « leurs compatriotes sont toujours pleins de compassion et peuvent prêter facilement. À ces gens, le village prend de l'argent de leurs propres poches ou fait un don pour aider le joueur et lui fournir nourriture et vêtements, à condition qu'il rembourse de la même manière ».
Selon les anciennes coutumes, dès la veille du Nouvel An (minuit jusqu'au premier jour de la nouvelle année), les Vietnamiens pratiquent des rituels de culte des ancêtres, le matin du premier jour, ils font des offrandes, offrant deux repas par jour jusqu'au matin du quatrième jour, ils font leurs adieux au Dieu du Tissu, certaines familles font des offrandes jusqu'au septième jour.
En plus de la cérémonie de culte, il y a une cérémonie d'argent porte-bonheur, où les jeunes s'agenouillent deux fois devant leurs aînés et reçoivent de l'argent porte-bonheur en retour. La coutume d'entrer en premier dans la maison de quelqu'un le premier jour de la nouvelle année avec le concept d'esprit « lourd » ou « léger » existe encore aujourd'hui, ce qui amène de nombreuses personnes à envisager de ne pas se précipiter chez quelqu'un d'autre le premier jour de la nouvelle année par peur d'être blâmées. Lors de la fête du Têt, les gens érigent souvent des poteaux et saupoudrent de poudre de chaux. Chaque maison possède un banh chung pour célébrer le Têt. Sans banh chung, c'est comme manquer le Têt...
En 1944, l'érudit Nguyen Van Vinh écrivait avec passion dans l'hebdomadaire Indochine qu'il ne fallait pas boycotter le Têt, mais les anciens avaient aussi un dicton : « le thoi vi dai » signifiant que la cérémonie doit être en phase avec l'époque, ce qui est la chose la plus importante. Respecter les rituels est la bonne chose à faire, mais réformer les coutumes et les rituels est également une question constante, en particulier dans le contexte moderne, que faut-il conserver, que faut-il abandonner, que faut-il simplifier pour une innovation progressive.
Le Nouvel An lunaire ou le Têt traditionnel du peuple vietnamien est une grande occasion, « il met fin à la longue chaîne continue du temps et rend la vie des gens et de toutes choses plus rythmée » (Jean Przyluski), c'est une occasion pour les gens de mettre de côté leurs soucis et préoccupations quotidiennes pour envoyer de l'amour et leurs meilleurs vœux, partager la joie ensemble, se souvenir de leurs ancêtres, se reposer, s'amuser et se réunir en famille et entre amis, pour jeter les soucis et les difficultés de la vieille année et accueillir ensemble les bonnes choses à venir...
On peut dire que les archives occidentales sur le Nouvel An traditionnel vietnamien apportent non seulement des perspectives nouvelles et riches sur la fête, mais montrent également que sous l'influence de la culture française, le Nouvel An traditionnel conserve toujours ses valeurs fondamentales, reflétant la vitalité et la résilience durables d'une culture nationale unique.
Source : https://thanhnien.vn/tet-viet-xua-qua-ghi-chep-cua-nguoi-phuong-tay-185250106165404594.htm





![[Photo] Les « Beautés » participent à la répétition du défilé à l'aéroport de Bien Hoa](https://vstatic.vietnam.vn/vietnam/resource/IMAGE/2025/4/11/155502af3384431e918de0e2e585d13a)
![[Photo] Retour sur les moments impressionnants de l'équipe de sauvetage vietnamienne au Myanmar](https://vstatic.vietnam.vn/vietnam/resource/IMAGE/2025/4/11/5623ca902a934e19b604c718265249d0)













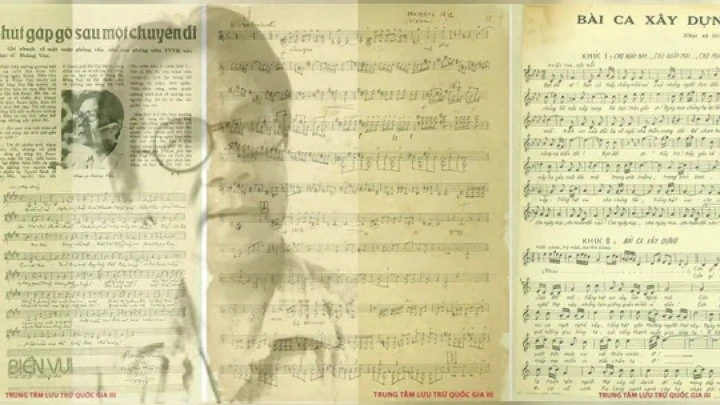


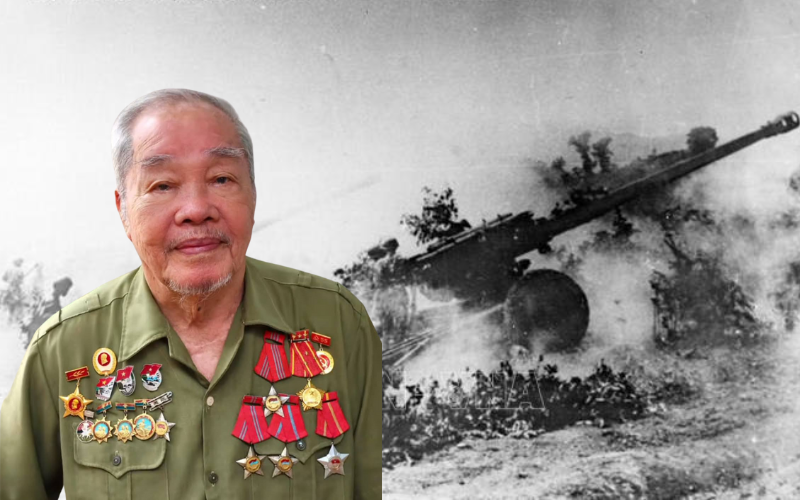








![[Photo] Résumé des exercices de défilé en préparation de la célébration du 30 avril](https://vstatic.vietnam.vn/vietnam/resource/IMAGE/2025/4/11/78cfee0f2cc045b387ff1a4362b5950f)





























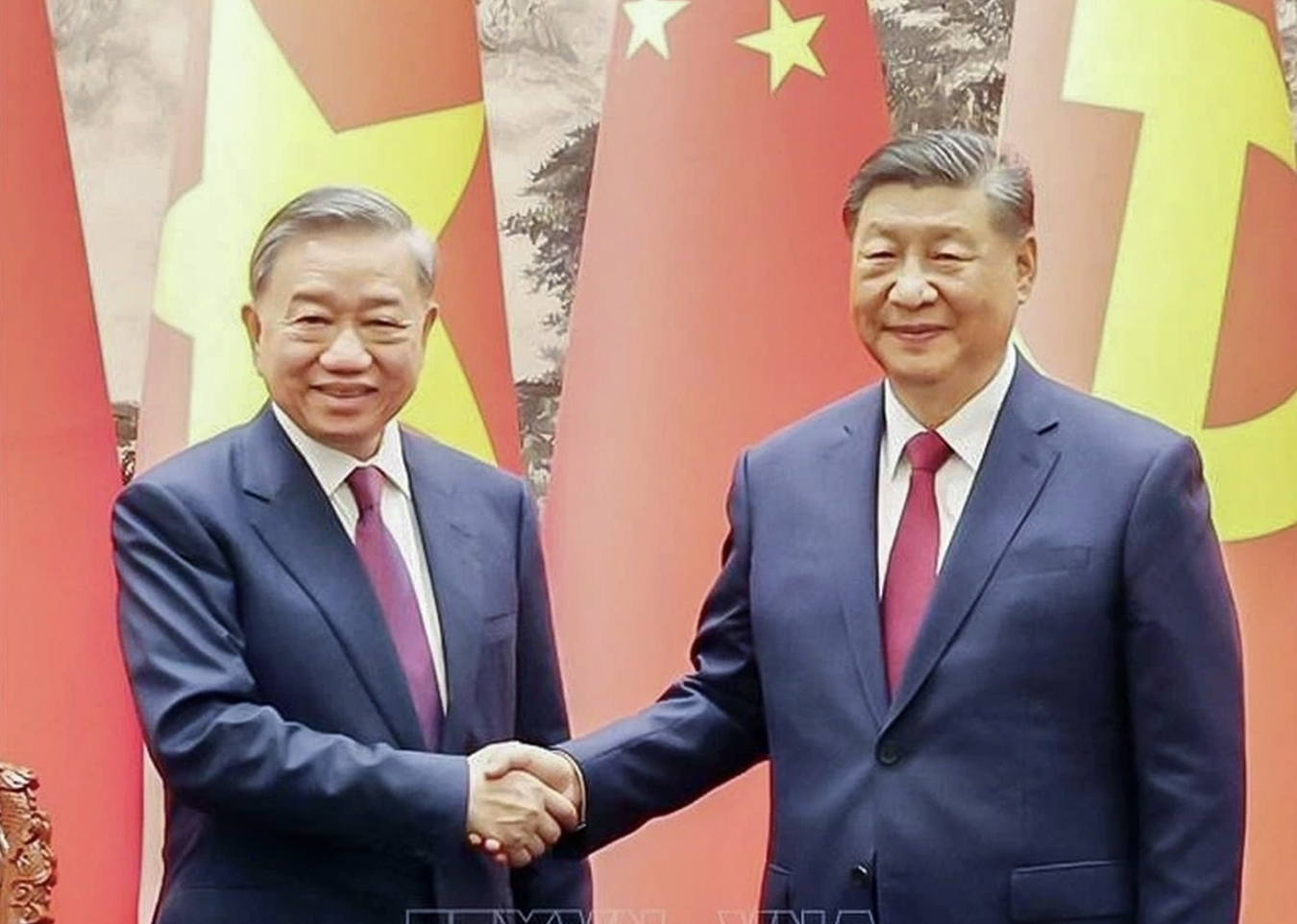



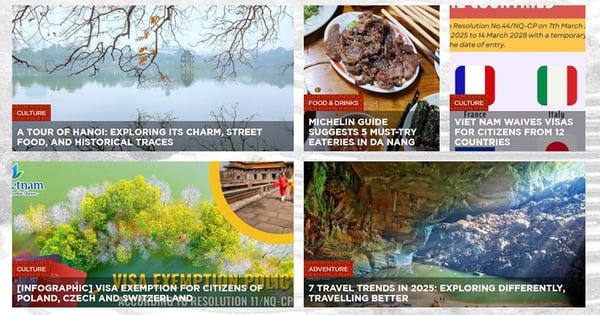



























Comment (0)