En mars 2022, peu après le lancement par la Russie d’une opération militaire spéciale en Ukraine, le président Biden a signé un décret interdisant les importations de pétrole, de gaz naturel liquéfié et de charbon russes pour empêcher le pays d’investir davantage d’argent dans le conflit.
Bien que l’interdiction, ainsi que les sanctions de l’UE, soient considérées comme ayant fait grimper les prix mondiaux de l’énergie, les raffineries américaines n’ont pas été les plus durement touchées, puisque la Russie ne fournit que 3 % des importations de brut américain.
Cependant, les observateurs ont rapidement souligné qu’un produit d’exportation notable n’était pas mentionné dans cette liste : l’uranium.
Pendant longtemps, les États-Unis ont largement dépendu de l’uranium russe. Le pays a importé environ 14 % de son uranium et 28 % de son uranium enrichi de Russie en 2021.
Vulnérable
Malgré l’appel du président ukrainien Volodymyr Zelensky aux États-Unis et à la communauté internationale pour interdire les importations d’uranium russe suite aux bombardements russes près de la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporizhzhya, les entreprises américaines continuent de payer environ 1 milliard de dollars par an à Rosatom, l’agence nucléaire publique russe, et importent 411,5 millions de dollars supplémentaires d’uranium enrichi au cours du seul premier trimestre 2023.
Le milliard de dollars représente une part importante des revenus étrangers de Rosatom, qui s'élèvent à environ 8 milliards de dollars par an, selon le Washington Post.

Rosatom, l'agence nucléaire publique russe, vend encore chaque année pour environ 1 milliard de dollars d'uranium aux États-Unis. Photo : Washington Post
Il s’agit de l’un des flux financiers les plus importants qui subsistent entre les États-Unis et la Russie, et il continue d’affluer, malgré les efforts des alliés des États-Unis pour rompre les liens économiques avec Moscou. Les paiements pour l’uranium enrichi sont effectués aux filiales de Rosatom, qui sont donc étroitement liées à l’appareil militaire russe.
Le désinvestissement de la Russie dans l'uranium est une décision difficile à prendre pour les États-Unis, étant donné que la Russie abrite l'une des plus grandes ressources d'uranium au monde, avec environ 486 000 tonnes d'uranium, soit l'équivalent de 8 % de l'approvisionnement mondial. La Russie abrite également le plus grand complexe d’enrichissement d’uranium au monde, représentant près de la moitié de la capacité mondiale.
Pendant ce temps, environ un tiers de l’uranium enrichi utilisé aux États-Unis est actuellement importé de Russie, le producteur le moins cher du monde. La majeure partie du reste est importée d’Europe. La dernière partie, plus petite, a été produite par un consortium anglo-néerlandais-allemand opérant aux États-Unis. Le pays n’a pas non plus de projet actuel de développer ou d’acquérir une capacité d’enrichissement d’uranium suffisante pour devenir autosuffisant à l’avenir.
Cette dépendance rend les centrales nucléaires américaines actuelles et futures vulnérables si la Russie cesse de vendre de l’uranium enrichi. Les analystes estiment que le président Vladimir Poutine est susceptible d’utiliser cette stratégie car il utilise souvent l’énergie comme un outil géopolitique.
Racines profondes
Bien que le conflit soit entré dans sa deuxième année sans fin en vue, le gouvernement américain ne semble pas pressé de lancer l’enrichissement de l’uranium sur son territoire.
« Il est inexplicable que plus d’un an après le conflit entre la Russie et l’Ukraine, l’administration Biden ne semble pas avoir de plan pour mettre fin à cette dépendance », a déclaré James Krellenstein, directeur de GHS Climate, un cabinet de conseil en énergie propre qui a récemment publié un livre blanc.
« Nous pouvons éliminer presque toute dépendance des États-Unis à l’égard de l’enrichissement d’uranium russe en achevant la construction de l’usine de centrifugation dans l’Ohio », a déclaré M. Krellenstein. Cependant, l'exploitant de la centrale de l'Ohio a déclaré qu'il pourrait falloir plus d'une décennie à la centrale pour produire des quantités d'uranium qui concurrenceraient celles de Rosatom.
La dépendance des États-Unis à l’uranium enrichi à l’étranger entraîne les mêmes inconvénients que sa dépendance aux puces électroniques et aux minéraux essentiels utilisés pour fabriquer des batteries électriques – deux composants essentiels de la transition énergétique mondiale.

De nombreuses usines d’enrichissement d’uranium aux États-Unis ont été fermées après que les États-Unis ont acheté de l’uranium à la Russie. Photo : NY Times
Cependant, dans le cas de l’enrichissement de l’uranium, les États-Unis avaient autrefois l’avantage et ont choisi de l’abandonner. À la fin de la guerre froide, les États-Unis et la Russie avaient des capacités d’enrichissement à peu près égales, mais il existait une grande différence dans les coûts de production, car la méthode de centrifugation russe s’est avérée 20 fois plus économe en énergie que la méthode de diffusion gazeuse américaine.
En 1993, Washington et Moscou ont signé un accord, baptisé « Megatons to Megawatts », dans lequel les États-Unis ont importé la majeure partie de l'uranium de qualité militaire de la Russie, qui a ensuite été déclassé pour être utilisé dans les centrales électriques. Cela fournit aux États-Unis du carburant bon marché et à Moscou de l’argent, et est perçu comme une mesure visant à apaiser les tensions entre les deux parties.
Cette coopération a finalement entraîné la fermeture d’installations américaines d’enrichissement d’uranium inefficaces. L’accord a pris fin en 2013, mais au lieu d’investir dans des centrifugeuses, les États-Unis ont continué à acheter de l’uranium enrichi à la Russie.
Si les États-Unis continuent de ne pas participer au processus d’enrichissement de l’uranium, l’écart entre Washington et ses rivaux va s’élargir, tandis que la Russie et la Chine se précipiteront pour remporter des contrats nucléaires à long terme avec des pays avec lesquels les États-Unis cherchent à renforcer leur coopération .
Nguyen Tuyet (selon le prix du pétrole, le New York Times et le Washington Post)
Source


![[Photo] Moment d'amour : les Birmans sont émus de remercier les soldats vietnamiens](https://vstatic.vietnam.vn/vietnam/resource/IMAGE/2025/4/3/9b2e07196eb14aa5aacb1bc9e067ae6f)
![[Photo] Le Premier ministre Pham Minh Chinh reçoit le vice-Premier ministre de la République de Biélorussie Anatoly Sivak](https://vstatic.vietnam.vn/vietnam/resource/IMAGE/2025/4/2/79cdb685820a45868602e2fa576977a0)
![[Photo] Camarade Khamtay Siphandone - un dirigeant qui a contribué à favoriser les relations entre le Vietnam et le Laos](https://vstatic.vietnam.vn/vietnam/resource/IMAGE/2025/4/3/3d83ed2d26e2426fabd41862661dfff2)


![[Photo] Des reliques spéciales au Musée d'histoire militaire du Vietnam associées à l'héroïque 30 avril](https://vstatic.vietnam.vn/vietnam/resource/IMAGE/2025/4/3/a49d65b17b804e398de42bc2caba8368)





















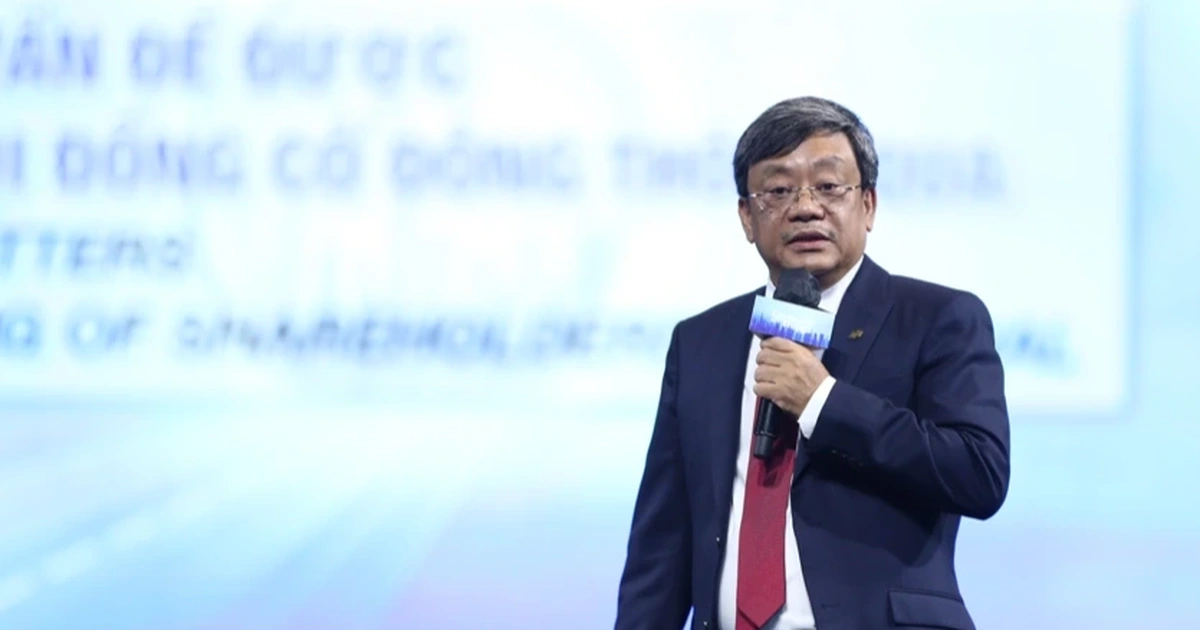




































































Comment (0)