À seulement deux jours de l’élection présidentielle américaine, les experts tentent de comprendre et d’analyser les plateformes potentielles de politique étrangère des deux principaux candidats. La vice-présidente Kamala Harris et l’ancien président Donald Trump ont chacun cherché à présenter l’autre comme « faible face à la Chine » dans le but de contourner l’opposition.
 |
| La vice-présidente Kamala Harris et l’ancien président Donald Trump cherchent à présenter l’autre comme « faible face à la Chine ». (Source : US Informal News) |
M. Trump a appelé à un tarif de 60 % sur toutes les importations en provenance de Chine, citant les marchés financiers mondiaux qui ne se sont pas encore remis de la pandémie de Covid-19 et qui ont du mal à s'adapter au découplage entre Washington et Pékin dans de nombreux domaines technologiques clés.
Mme Harris a souligné que son objectif en tant que nouvelle présidente sera de « garantir que l’Amérique remporte la compétition au 21e siècle ».
Pour certains commentateurs qui suivent de près l’Asie, il y aura peu de différence entre les deux candidats à la présidentielle. Après tout, M. Trump et Mme Harris vantent tous deux la puissance américaine et conviennent que la première économie mondiale est engagée dans une compétition à somme nulle avec la Chine.
En fait, il y a deux dures vérités que les Démocrates et les Républicains doivent accepter s’ils veulent élaborer une stratégie asiatique durable : premièrement, l’Amérique ne jouira plus du statut inégalé de seule superpuissance mondiale . Deuxièmement , les capacités de la Chine ne sont plus considérées avec suspicion à l’échelle mondiale.
Selon la plupart des mesures objectives, la position de Washington en Asie devrait être plus sûre d’ici la fin de 2024 qu’elle ne l’était en 2020.
Plus précisément, l’administration Biden a désormais accès à neuf bases militaires aux Philippines, dans le cadre de l’Accord de coopération renforcée en matière de défense (EDCA) signé en 2014. En 2023, les États-Unis ont établi un nouveau triangle avec deux alliés traditionnels en Asie du Nord-Est, le Japon et la Corée du Sud, et ont achevé la mise à niveau du partenariat stratégique avec le Vietnam.
Cependant, malgré les avancées remarquables réalisées récemment par Washington, le déclin de l’influence de la première superpuissance mondiale dans la région asiatique s’annonce inquiétant.
En continuant d’adopter une stratégie de reconnaissance implicite du leadership mondial tout en se distanciant de la structure économique régionale en évolution en refusant de participer aux accords de libre-échange, les États-Unis perdent progressivement leur influence sur le plus grand continent de la planète.
Le manque d’attention et l’incohérence de l’administration Biden sont à l’origine de la situation actuelle, et celle-ci peut être corrigée, mais le temps presse.
Bien que les décideurs politiques américains soulignent fréquemment que Washington est le plus grand investisseur direct étranger en Asie du Sud-Est, cela n’est vrai que si l’on considère les stocks d’investissement totaux. Selon de nouvelles données du Lowy Institute for International Policy, au cours de la dernière décennie, la Chine a investi beaucoup plus dans la région que les États-Unis (218 milliards de dollars contre 158 milliards de dollars).
Qu'elle soit démocrate ou républicaine, la prochaine administration a l'opportunité de remodeler la politique asiatique de Washington pour répondre aux demandes d'un rôle américain plus actif et plus équilibré dans la région, affirment les analystes. En conséquence, le prochain occupant de la Maison Blanche devrait prendre en compte trois principes pour parvenir au bon équilibre :
Premièrement, les pays asiatiques souhaitent une présence américaine plus modérée et plus durable, fondée non seulement sur des partenariats de sécurité et des bases militaires, mais aussi sur la capacité à fournir les ressources nécessaires, telles que les investissements économiques et le financement du développement, pour répondre aux besoins de la classe moyenne en pleine croissance de la région.
La classe moyenne asiatique devrait atteindre 3,5 milliards de personnes d’ici 2030, devenant ainsi la plus grande du monde. Un rapport de 2019 de la Banque asiatique de développement (BAD) estime que les besoins en infrastructures des pays en développement de la région Indo-Pacifique atteindront 1,7 billion de dollars par an jusqu'en 2030, si l'on tient compte de l'adaptation au changement climatique.
Pourtant, selon une étude récente, le financement public du développement en Asie du Sud-Est devrait atteindre en 2022 son plus bas niveau depuis 2015, en termes réels.
Deuxièmement , les États-Unis n’ont pas nécessairement besoin d’être le pays le plus puissant pour pouvoir contribuer positivement à l’ordre régional. Les décideurs politiques de Washington continuent d’élaborer des stratégies régionales en partant du principe que les États-Unis restent la première puissance mondiale et qu’ils ne sont pas contestés en Asie. Cependant, il s’agit d’un objectif irréaliste.
On dit qu’une politique étrangère fondée sur la suprématie gaspille des ressources rares et exerce une pression sur les décideurs politiques, en particulier à un moment où les électeurs américains sont particulièrement préoccupés par la « santé » de l’économie et des soins de santé.
En fin de compte , les pays asiatiques ne veulent pas être obligés de choisir entre les deux superpuissances que sont la Chine et les États-Unis. La Chine a toujours été le principal partenaire économique des pays asiatiques et cela continuera à être affirmé et maintenu.
Confronté aux contraintes pesant sur son pouvoir et son influence, le nouveau président américain doit reconnaître la valeur des alliances et des partenariats de l’Amérique à travers le monde ; continuer à donner du pouvoir aux partenaires et alliés désireux de jouer un rôle constructif dans le maintien de l'ordre international fondé sur des règles
Pourtant, aucune des deux parties ne montre le moindre signe d’abandon de sa trajectoire actuelle – qui donne la priorité à la concurrence avec la Chine à tout prix, avec le vague objectif de remporter cette compétition stratégique.
Bien que la politique étrangère n’ait jamais été une question prioritaire lors d’une élection américaine, elle figure relativement haut dans la liste des préoccupations des électeurs du pays : 62 % de tous les électeurs ont déclaré que la politique étrangère était très importante pour décider pour qui voter (70 % des partisans de Trump et 54 % des partisans de Harris).
M. Trump et Mme Harris veulent tous deux mettre en avant leur rôle de candidats du « changement », et le changement est exactement ce dont la future stratégie américaine en Asie a besoin. L’élection offre une occasion précieuse de repenser les objectifs de Washington dans le contexte des réalités mondiales du XXIe siècle.
Source : https://baoquocte.vn/enceinte-ma-enceinte-avant-le-milieu-de-l-epidemie-de-chine-van-gia-tang-suc-anh-huong-chien-luoc-chau-a-se-duoc-dinh-hinh-ra-sao-292375.html


![[Photo] Conférence nationale pour diffuser et mettre en œuvre la résolution n° 66-NQ/TW et la résolution n° 68-NQ/TW du Politburo](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/5/18/adf666b9303a4213998b395b05234b6a)
![[Photo] Le Premier ministre Pham Minh Chinh préside une réunion sur le développement scientifique et technologique](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/5/17/ae80dd74c384439789b12013c738a045)
![[Photo] Plus de 17 000 candidats participent au test d'évaluation des compétences SPT 2025 de l'Université nationale d'éducation de Hanoi](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/5/17/e538d9a1636c407cbb211b314e6303fd)

























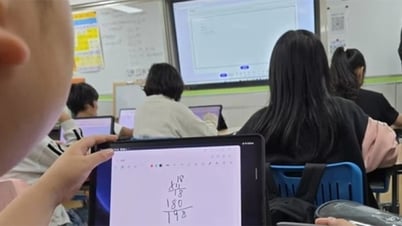



![[Photo] Les lecteurs font la queue pour visiter l'exposition de photos et recevoir une publication spéciale commémorant le 135e anniversaire du président Ho Chi Minh au journal Nhan Dan](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/5/17/85b3197fc6bd43e6a9ee4db15101005b)














































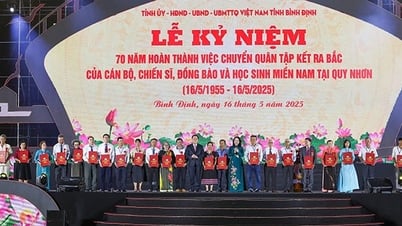


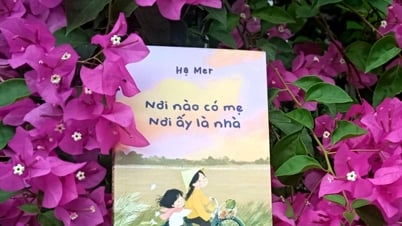








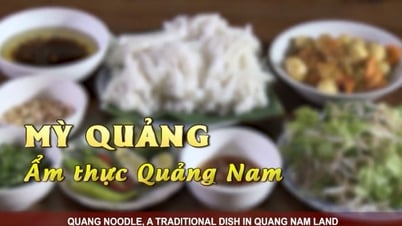






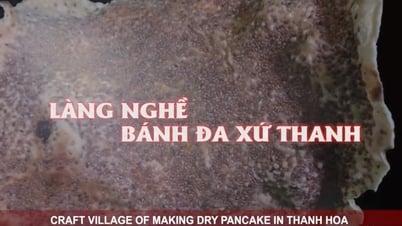


Comment (0)