(NB&CL) L’ordre géopolitique mondial subit de profonds changements avec l’émergence de nouveaux groupes de forces, capables de modifier l’équilibre des pouvoirs. Dans ce contexte, la victoire de Donald Trump à l’élection présidentielle américaine de 2024 entraînera des ajustements dans la politique étrangère américaine, affectant le reste du monde.
L’Occident pourrait être confronté à la division
De nombreux avis affirment que le président Donald Trump modifiera profondément la politique étrangère américaine au cours de son nouveau mandat. M. Trump a déclaré qu’il ne défendrait pas un pays de l’OTAN s’il ne dépensait pas suffisamment d’argent pour sa défense collective.
Il y a même eu des spéculations selon lesquelles M. Trump se retirerait effectivement de l’OTAN, même si le prix à payer pour abandonner un allié traditionnel serait énorme. Au cours des 80 dernières années, l’Amérique a agi comme une superpuissance mondiale pour défendre l’Occident et ses valeurs communes de liberté politique et économique. Les diplomates craignent qu’un abandon de l’approche traditionnelle ne crée un « vide » permettant aux concurrents des États-Unis, comme la Russie et la Chine, de continuer à étendre leur influence, en particulier dans les domaines de concurrence géopolitique stratégique. Le choix par M. Trump du sénateur de l'Ohio JD Vance comme colistier ajoute encore à ces inquiétudes, car M. Vance a été l'un des critiques les plus virulents de l'augmentation de l'aide de Washington à l'Ukraine.
L’Union européenne devrait également se préparer à une nouvelle détérioration de ses relations commerciales avec les États-Unis. Dans une interview en juillet, M. Trump a une fois de plus accusé les Européens de traiter les États-Unis de manière injuste. Ces aspects, ainsi que la question des contributions des États membres de l’OTAN au budget national, continueront d’approfondir les désaccords entre les États-Unis et leurs alliés européens.

Le président américain Donald Trump. Illustration : Socialeurope
Le trépied États-Unis-Russie-Chine
Dans les relations avec la Russie, l’administration Trump est susceptible de reprendre les canaux de communication avec la Russie, non seulement sur la question ukrainienne, mais aussi pour résoudre les conflits et les désaccords entre les deux pays. Toutefois, selon le Dr Ivan Timofeev, directeur général du Conseil russe des affaires internationales (RIAC), les relations entre les États-Unis et la Russie sont déterminées par des facteurs structurels et non par le rôle personnel du président américain.
Par conséquent, la froideur des relations entre les deux pays s’est manifestée sous la présidence de Joe Biden et continuera probablement à se maintenir pendant le mandat du président Donald Trump. M. Trump fera pression plus activement pour que les États-Unis puissent contrôler et dominer le marché européen, en particulier dans le contexte de la poursuite de la guerre d'embargo entre l'Union européenne (UE) et la Russie, cette tendance de M. Trump devient de plus en plus réaliste.
Durant son mandat de 2016 à 2020, Donald Trump s’est montré partisan d’une politique d’endiguement croissant de la Chine. La rhétorique anti-chinoise de M. Trump s’accompagne de mesures restrictives très spécifiques. Durant le mandat de Joe Biden, la politique anti-chinoise des États-Unis a été quelque peu plus modérée, mais la concurrence fondamentale entre les deux pays continue d’être maintenue. Cependant, le retour de M. Trump signifie que l’approche américaine envers Pékin sera plus agressive et affirmée, ce qui entraînera le risque d’une guerre commerciale féroce entre les deux puissances.
En bref, à l’ère « Trump 2.0 », l’approche des États-Unis à l’égard de la Russie et de l’Ukraine sera probablement ajustée par rapport à l’administration précédente ; Car d’un point de vue personnel, M. Trump ne considère pas la Russie comme un adversaire. En outre, M. Trump ne souhaite pas non plus un scénario dans lequel la Russie et la Chine se rapprocheraient, créant ainsi un contrepoids plus important pour les États-Unis et leurs alliés. Il est donc probable que la politique de M. Trump crée certains obstacles dans les relations entre la Russie et la Chine, créant un trépied « à la fois coopératif et défensif » entre les trois puissances.

Le trépied États-Unis-Chine-Russie. Photo d'illustration : Reuters
Le Moyen-Orient reste un point chaud
Les analystes estiment que le soutien de l’administration Trump à Israël au cours des quatre prochaines années ne sera pas à la même échelle que durant son premier mandat. Plusieurs facteurs rendent la situation actuelle au Moyen-Orient beaucoup plus compliquée et obligent Washington à être plus réfléchi qu’auparavant dans la définition de ses objectifs politiques dans la région.
Sur la question du nucléaire iranien, la victoire de Donald Trump risque d'entraîner une pression accrue en raison de la position plus dure du Parti républicain sur les relations avec la République islamique. Pour Téhéran, une victoire républicaine pourrait entraîner une nouvelle vague de sanctions. Il est possible que de nouveaux décrets exécutifs voient le jour, renforçant les régimes de sanctions et adoptant de nouvelles lois sur des mesures restrictives contre l’Iran, faisant du Moyen-Orient un point chaud du monde .
Focus stratégique dans la région indo-pacifique
Les analystes estiment que dans les temps à venir, les États-Unis intensifieront leurs activités stratégiques dans la région indo-pacifique, en se concentrant sur la concurrence d’influence avec la Chine dans les domaines commercial, technologique et géopolitique, comme la question nucléaire dans la péninsule coréenne ou les tensions dans le détroit de Taiwan ; Parallèlement, renforcer la coopération avec les alliés et partenaires traditionnels tels que le Japon, la Corée du Sud, les Philippines, l’Inde, l’Australie, etc.
En particulier, l’ASEAN continuera de jouer un rôle majeur dans la stratégie indo-pacifique de l’administration Trump. En fait, au cours du premier mandat du président Trump, la coopération entre les États-Unis et l’ASEAN s’est fortement développée. Sur le plan économique, les États-Unis sont actuellement le plus grand investisseur direct étranger dans l'ASEAN, le total des échanges commerciaux entre les deux parties atteignant 500 milliards de dollars d'ici 2023. Depuis 2002, les États-Unis ont fourni plus de 14,7 milliards de dollars d'aide économique, sanitaire et sécuritaire aux pays de la région, affirmant ainsi leur rôle indispensable dans le développement global de l'ASEAN. La coopération en matière de sécurité et de défense entre les États-Unis et les pays de la région s’est également renforcée ces derniers temps.
Cependant, le scénario d’une victoire de M. Trump aux élections pourrait également amener les pays de l’ASEAN à modifier considérablement leur approche. Le problème le plus imminent est qu’un second mandat de Trump devrait déjà s’accompagner d’importantes augmentations des tarifs douaniers (susceptibles de créer des tensions commerciales mondiales), ce qui aura un impact majeur sur les réseaux de production à travers l’Asie, en particulier en Asie du Sud-Est. Cela exige que les pays de la région procèdent à des ajustements stratégiques appropriés pour garantir leurs intérêts nationaux dans le nouveau contexte.
Ha Anh
Source : https://www.congluan.vn/ky-nguyen-trump-20-va-nhung-tac-dong-den-trat-tu-the-gioi-moi-post331234.html


![[Photo] Le Premier ministre Pham Minh Chinh préside une réunion sur le développement scientifique et technologique](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/5/17/ae80dd74c384439789b12013c738a045)
![[Photo] Plus de 17 000 candidats participent au test d'évaluation des compétences SPT 2025 de l'Université nationale d'éducation de Hanoi](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/5/17/e538d9a1636c407cbb211b314e6303fd)

![[Photo] Les lecteurs font la queue pour visiter l'exposition de photos et recevoir une publication spéciale commémorant le 135e anniversaire du président Ho Chi Minh au journal Nhan Dan](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/5/17/85b3197fc6bd43e6a9ee4db15101005b)














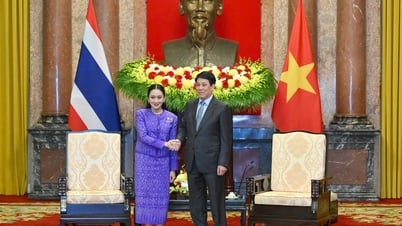
















![[Photo] Près de 3 000 étudiants émus par des histoires de soldats](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/5/17/21da57c8241e42438b423eaa37215e0e)




































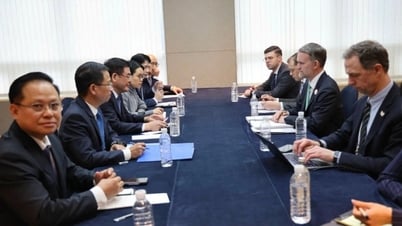



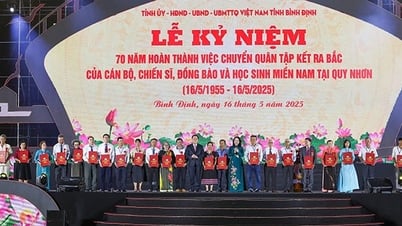


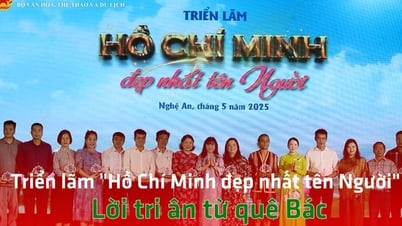
















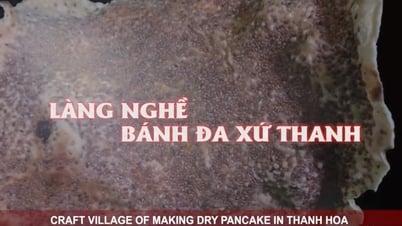






Comment (0)