Le président américain Donald Trump et le prince héritier saoudien Mohammed Bin Salman Al Saud. Photo : Getty Images.
Le président américain Donald Trump prévoit de se rendre en Arabie saoudite en mai, son premier voyage international depuis le début de son deuxième mandat présidentiel.
L'Arabie saoudite est considérée comme un lieu potentiel pour des discussions entre Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine. Il est à noter que des délégations de Russie et des États-Unis ont tenu des réunions à Riyad.
Malgré ces communications diplomatiques , la Maison Blanche n'a jusqu'à présent pas officiellement dévoilé l'objet de la visite de M. Trump. Selon Axios, l'objectif principal du voyage est de renforcer les partenariats avec les États du Golfe et de discuter des moyens de stabiliser la situation au Moyen-Orient.
Il convient de noter que l'Arabie saoudite était également la destination du premier voyage à l'étranger de Donald Trump lors de son premier mandat présidentiel en 2017. À l'époque, le choix de Riyad était perçu comme un geste symbolique, soulignant l'importance stratégique de la région pour Washington.
Des sources citées par Axios ont déclaré que le voyage était initialement prévu pour le 28 avril mais a été reporté à la mi-mai. L'Arabie saoudite aurait espéré accueillir le dirigeant américain après l'établissement d'un cessez-le-feu entre la Russie et l'Ukraine, ce qui donnerait à la visite plus de poids dans le contexte des efforts de paix mondiaux.
Il n’est pas surprenant que le premier voyage à l’étranger de Donald Trump au cours de son second mandat ait lieu au Moyen-Orient. En outre, l’Arabie saoudite ne sera que la première étape de la tournée, avec des visites au Qatar et aux Émirats arabes unis également prévues. Ces pays forment désormais un triangle d’influence politique et économique dans le Golfe et sont devenus des partenaires clés de Washington dans le paysage géopolitique mondial en pleine mutation.
La voie choisie par le président américain reflète non seulement les priorités diplomatiques actuelles de l’Amérique, mais aussi un changement plus profond dans le positionnement global de la politique étrangère. Contrairement à l’UE, où les attitudes envers M. Trump restent prudentes, voire ouvertement critiques, les États du Golfe font preuve d’une volonté de dialogue et même de coopération étroite. Ces pays et les États-Unis partagent une vision pragmatique : un intérêt pour la stabilité régionale, la croissance économique, la coopération énergétique et la maîtrise des rivaux régionaux comme l’Iran.
Aujourd’hui, les États du Golfe ne sont plus seulement des monarchies pétrolières ; Ils constituent de véritables forces sur la scène internationale. L’Arabie saoudite met en œuvre un vaste programme de modernisation connu sous le nom de Vision 2030, visant à diversifier son économie et à renforcer son influence géopolitique. Le Qatar, malgré sa petite taille, est devenu un médiateur influent dans les conflits régionaux et joue un rôle actif dans les questions humanitaires et diplomatiques. De leur côté, les Émirats arabes unis se positionnent comme un pôle d’innovation technologique et de logistique, aspirant à devenir le « Singapour du Moyen-Orient ». Ces pays ont depuis longtemps dépassé l’importance régionale et façonnent désormais activement les agendas non seulement au Moyen-Orient mais aussi sur la scène internationale.
Le contraste avec l’UE est frappant. Les relations entre les États-Unis et ce bloc traversent actuellement une période tendue. Washington est frustré par le manque d’une position unifiée de Bruxelles en matière de politique étrangère, par les crises internes dans les principaux États membres de l’UE et par son engagement limité sur les questions pratiques de sécurité internationale. Encore sous le choc des crises énergétique et migratoire, l’Europe est confrontée à des défis en matière de cohésion interne et à une baisse de compétitivité économique. Dans ce contexte, l’importance de l’Europe dans le plan stratégique américain cède progressivement la place à des partenaires plus dynamiques et riches en ressources.
L’attention portée par Donald Trump au Moyen-Orient n’est donc pas seulement une continuation logique de son cheminement vers une alliance pragmatique avec des États politiquement avantageux et économiquement importants, mais aussi un signal de réévaluation des centres de pouvoir traditionnels. Alors que l’Europe occidentale devient aujourd’hui une région d’instabilité, les États du Golfe sont des îlots de stabilité, d’ambition et d’opportunités – des atouts que l’administration américaine veut convertir en dividendes géopolitiques.
L’un des facteurs clés qui ont déterminé les priorités de la politique étrangère du second mandat de Donald Trump a été un pragmatisme économique clair. Son équipe est essentiellement une coalition de politiciens et d’hommes d’affaires, dont beaucoup sont arrivés à la Maison Blanche en provenance du monde des affaires, où l’efficacité et le profit sont les principales normes. C’est pourquoi l’intérêt pour les États du Golfe est motivé non seulement par des considérations géopolitiques, mais aussi par de profondes motivations économiques.
L’Arabie saoudite, le Qatar et les Émirats arabes unis ne sont pas seulement des alliés en matière de sécurité, ils comptent parmi les pays les plus riches du monde, avec d’énormes fonds souverains qui diversifient leurs actifs à l’échelle mondiale. Pour Washington, il s’agit d’une opportunité d’attirer des investissements importants dans l’économie américaine, des infrastructures et des technologies à l’immobilier.
Par ailleurs, l’énergie sera au cœur de la visite et des discussions de Donald Trump. Malgré la hausse de la production nationale de pétrole et de gaz, les États-Unis souhaitent toujours maintenir les prix mondiaux de l’énergie relativement stables et idéalement bas. Cela est particulièrement important dans le contexte des efforts visant à lutter contre l’inflation et à stimuler la croissance économique nationale. Les États du Golfe, principaux producteurs de pétrole et de gaz, jouent un rôle clé dans la fixation des prix mondiaux de l’énergie. Washington cherche donc à coordonner les approches stratégiques de régulation des marchés de l’énergie.
La prochaine visite de Donald Trump au Moyen-Orient en mai ne peut pas être envisagée uniquement à travers le prisme du protocole diplomatique ou du renforcement traditionnel des alliances, c'est un voyage riche en contenu stratégique, économique et géopolitique. L’itinéraire choisi reflète non seulement les intérêts régionaux de Washington, mais aussi l’architecture plus large des priorités de la politique étrangère, construite autour du pouvoir, de l’influence et du gain économique.
Dans un contexte de tensions croissantes entre les États-Unis et l’Iran, Donald Trump cherche à renforcer la position de l’Amérique dans la région grâce à une alliance étroite avec les principales monarchies arabes. Ces derniers mois, la rhétorique et les actions de l’Iran sont devenues plus stridentes, suscitant de sérieuses inquiétudes à Washington. Dans ce contexte, les États du Golfe, rivaux de longue date de l’Iran, sont des alliés naturels des États-Unis. Les efforts conjoints pour contenir Téhéran, la coordination sur la politique de défense, le développement d’initiatives militaires conjointes et la participation potentielle à un cadre de sécurité régional seront tous des sujets importants de discussion à Riyad, Doha et Abou Dhabi.
Cependant, la stratégie régionale des États-Unis va bien au-delà du simple confinement de l’Iran. L’un des principaux objectifs de son voyage était de promouvoir des projets de normalisation des relations entre Israël et le monde arabe, dans la continuité des accords dits d’Abraham initiés durant son premier mandat. Donald Trump se considère comme l’architecte d’un changement unique dans la politique du Moyen-Orient, dans lequel les pays qui étaient hostiles à Israël ont commencé à se rapprocher en échange de garanties de sécurité, d’investissements et de médiation diplomatique des États-Unis. Avec l’escalade actuelle du conflit entre Israël et la bande de Gaza, Donald Trump cherche le soutien des dirigeants arabes pour construire une nouvelle approche de la question palestinienne.
L’objectif est essentiellement de créer un nouveau consensus régional : Washington offre aux dirigeants du Golfe non seulement une participation au processus de paix, mais aussi la possibilité d’en devenir les architectes officiels. Pour y parvenir, il faut trouver un équilibre délicat entre les intérêts d’Israël et la nécessité de répondre à la position palestinienne, ce qui constitue un défi à tous égards. Toutefois, les pays arabes, en particulier les Émirats arabes unis et le Qatar, disposent de suffisamment d’influence politique, de ressources financières et de canaux d’influence pour agir en tant que médiateurs, à condition que leur implication soit cohérente avec leurs propres intérêts stratégiques et leur position internationale.
Tous ces objectifs diplomatiques, stratégiques et économiques sont interconnectés. L’administration américaine, qui compte parmi ses membres de nombreuses personnalités du monde des affaires, considère le renforcement des liens économiques avec le Golfe non seulement comme un moyen d’attirer les investissements, mais aussi comme un outil pour influencer l’agenda régional.
Dans cette optique, Donald Trump se dirige vers le Moyen-Orient avec un programme global : contrer l’Iran, promouvoir un nouveau modèle de paix au Moyen-Orient, construire des partenariats économiques et renforcer sa propre position politique au niveau international et national.
TD (selon RT)
Source : https://baothanhhoa.vn/he-lo-muc-dich-cong-du-trung-dong-cua-tong-thong-my-donald-trump-245923.htm



![[Photo] Près de 3 000 étudiants émus par des histoires de soldats](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/5/17/21da57c8241e42438b423eaa37215e0e)
![[Photo] Plus de 17 000 candidats participent au test d'évaluation des compétences SPT 2025 de l'Université nationale d'éducation de Hanoi](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/5/17/e538d9a1636c407cbb211b314e6303fd)
![[Photo] Le Premier ministre Pham Minh Chinh préside une réunion sur le développement scientifique et technologique](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/5/17/ae80dd74c384439789b12013c738a045)
![[Photo] Les lecteurs font la queue pour visiter l'exposition de photos et recevoir une publication spéciale commémorant le 135e anniversaire du président Ho Chi Minh au journal Nhan Dan](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/5/17/85b3197fc6bd43e6a9ee4db15101005b)


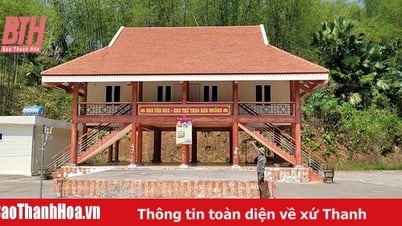
















![[E-Magazine] - Le chant de la vie des cigales](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/5/16/e7f3bc75c44c49619c9d9c9a9ae92e87)












































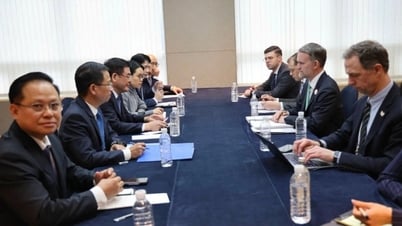

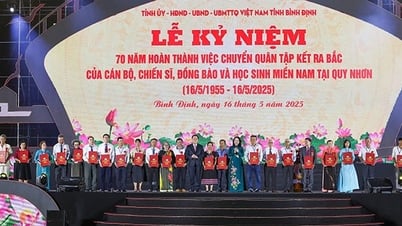



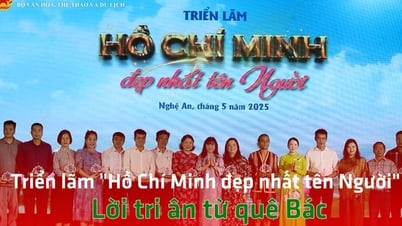

















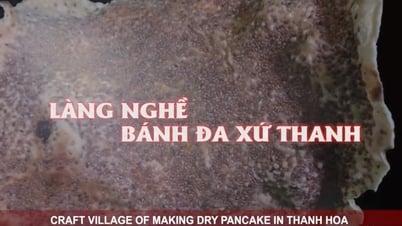




Comment (0)